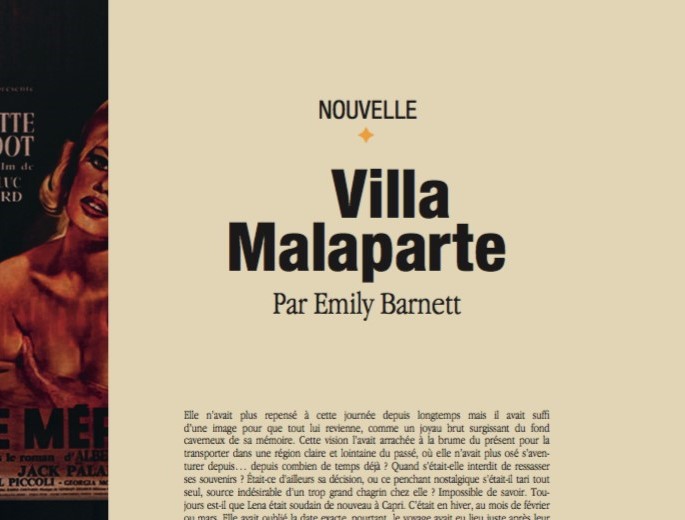Pour le premier numéro de la revue FrenchMania, Emily Barnett, journaliste cinéma (Les Inrockuptibles, Le Cercle) et romancière (“Les Oiseaux de passage” chez Flammarion) avait écrit une nouvelle inspirée du Mépris de Jean-Luc Godard.
Découvrez “Villa Malaparte”, en guise d’hommage…
Elle n’avait plus repensé à cette journée depuis longtemps mais il avait suffi d’une image pour que tout lui revienne, comme un joyau brut surgissant du fond caverneux de sa mémoire. Cette vision l’avait arrachée à la brume du présent pour la transporter dans une région claire et lointaine du passé, où elle n’avait plus osé s’aventurer depuis… depuis combien de temps déjà ? Quand s’était-elle interdit de ressasser ses souvenirs ? Etait-ce d’ailleurs sa décision, ou ce penchant nostalgique s’était-il tari tout seul, source indésirable d’un trop grand chagrin chez elle ? Impossible de savoir. Toujours est-il que Lena était soudain de nouveau à Capri. C’était en hiver, au mois de février ou mars. Elle avait oublié la date exacte, pourtant le voyage avait eu lieu juste après leur mariage à elle et Sam. Février donc… À l’époque, quelle déception ! Lena rêvait de mers turquoise, de grottes ombragées, de bougainvilliers aux pétales mauves longeant d’adorables villages blanchis à la chaux… Que nenni !
En débarquant de bateau à Marina Grande, le port de Capri, elle avait compris le sens de l’expression « hors-saison » : le ciel d’un gris uniforme pesait sur les toitures d’une petite agglomération sans charme, et la plupart des magasins étaient fermés. C’était une déception pour Lena qui aimait plus que tout (enfin pas tout, mais presque !) faire du lèche-vitrine en voyage, aller d’échoppe en échoppe, telle une abeille enivrée de pollen. Face aux bibelots pour touristes, les porte-clés, chapeaux et autres boules-à-neige, elle ne pouvait s’empêcher d’avoir une pensée pour sa famille, leurs amis, qui n’avaient pas comme eux la chance de visiter l’Italie. À Naples, Lena portait un sac rempli de babioles, manie qui avait le don d’exaspérer son mari. Son mari ! Comme elle aimait le présenter ainsi aux gens, chaque fois qu’ils faisaient de nouvelles rencontres… Ce bonheur de posséder l’autre – même illusoirement – et d’être possédée par lui. Le jour de leur arrivée à Capri, donc, Sam avait lu la déception sur son visage. Une contrariété de petite fille, elle en avait conscience, tandis qu’une moue triste assombrissait son visage. Alors Sam lui avait pris la main et l’avait entraînée chez un loueur de mobylettes. Les jours suivants, ils les avaient passés à sillonner l’île dans un bruit pétaradant de moteur, heureux et bravant le vent, et même ce qu’on appelait le foehn dans les hauteurs, une brume épaisse et glacée.
Désormais, de son appartement qui donnait sur un balcon, Lena voyait briller presque tous les jours le soleil. Ses longs après-midis désœuvrés, elle les passait à sentir la chaleur pulser sur son visage, comme un chat paresseux qui ne se sent plus coupable de ne pas interrompre sa sieste. C’était d’ailleurs au terme d’un de ces bains de soleil derrière la vitre (l’exposition aux UV lui était formellement déconseillée, du moins sans une solide protection, aussi elle ne mettait quasiment jamais les pieds dehors), après avoir baissé le store et allumé la télévision, que Lena était tombé sur ce film étrange, assez déplaisant en vérité, mais qui avait produit en elle un choc, celui de la réminiscence involontaire, un bond désobéissant de la mémoire qui avait figé son corps sur place. Lena était soudain transportée dans un Capri aussi opaque – dans cette double confusion d’une météo mauvaise et des brumes de sa propre idée – que sur l’écran il apparaissait bleu et solaire. L’image d’une île de rêve qu’elle n’avait pas connue. Mais qui, à présent, semblait contenir l’image défunte et irréelle de son rêve à elle, un fragment lumineux de sa vie passée.
« Regarde, c’est la Villa Malaparte ! » s’était écrié Sam, pointant son index vers l’océan, en bas de la falaise. Lena avait ajusté son regard en direction d’un rocher dominé par une bâtisse rose, dont le toit débutait par un large escalier. On ne voyait pas entièrement la maison cachée par les pins et les arbousiers. Mais du chemin côtier où ils se trouvaient, elle semblait vide. Déserte et pourtant… Comme pour marquer le coup, Sam alluma une cigarette et souffla lentement la fumée. Lena aimait que son mari fume, des gitanes dans leur paquet bleue, l’odeur de tabac lui allait bien, se mariait à son parfum de sable et de terre, de lait et d’amande parfois. Sam… Sam, ses yeux verts. Fendus et perçants comme ceux d’une panthère, flottant par-dessus les fonds marins… Après avoir contemplé la villa, Lena s’était retournée, l’air interrogatif, vers son mari. « Tu te souviens ce film, on l’a vu… ». Lena cherchait. « Non, je ne vois pas. » Sam parlait de Brigitte Bardot. Il évoquait les fesses et le corps nu de l’actrice et la jalousie, comme un poignard, l’avait transpercée. Non, elle n’avait pas vu ce film, avait-elle répliqué sur un ton plutôt acerbe, mais ce n’était pas l’évocation de Bardot qui l’irritait, filmée comme une statue antique expliquait Sam d’un air docte tout à coup, ce qui l’agaçait et la brûlait à l’intérieur, c’était d’imaginer Sam la confondant, elle, avec une autre – avec l’une des filles qu’il fréquentait à Paris avant leur rencontre. Sam y passait ses week-ends quand il faisait son école d’ingénieur, et l’un de ses cousins avait confié à Lena, un soir où ils avaient tous un peu trop bu, qu’à l’époque Sam « changeait de petite amie comme de chaussette. » Ils avaient tous les deux ri mais secrètement, Léna était mortifiée. Bêtement, elle s’était imaginée qu’elle avait peut-être été la première… Oui leur première nuit, il lui avait bien dit… Elle avait cru comprendre que Sam n’avait jamais… C’était faux évidemment ! Et à présent qu’elle fixait ses mains fermes, d’où dépassait le mégot fumant, et au-dessus son visage, son teint hâlé, ses dents blanches captives d’un sourire rêveur, elle était saisie par une jalousie rétrospective, bien que l’objet d’un tel et pitoyable sentiment fut dorénavant l’homme qui partageait sa vie. Son doux et tendre mari… Elle se glissa dans ses bras et Sam la serra fort contre lui.
Le matin de leur cinquième jour sur l’île, après un copieux petit déjeuner composé de croissants à la confiture et de deux grands cappuccinos commandés dans un café près de leur hôtel, peinant à ouvrir les yeux tant la nuit, comme les précédentes, avait été secouée d’étreintes, tantôt tendres, tantôt folles et passionnées, jusqu’à se mordre et s’insulter, Sam et Lena avaient enfourché la mobylette direction la côte-est de leur majestueux rocher. Car ils se sentaient, à tort, maîtres des lieux désormais, suivant cette espèce d’orgueil des jeunes amoureux. Leur arrogance grandissait avec leur amour, et celui-ci les mettait au-dessus de tout. Rien, même Pompéi visité quelques jours auparavant, avec ses vestiges figés par le feu, ses traces d’humanité tordues dans la lave, ses précieuses mosaïques et son vaste théâtre n’arrivaient à la cheville de leur amour ! Et cette cité du passé, ils la foulaient d’un pas léger et insouciants, comme un lieu de passage éphémère de leur couple voué, lui, à être éternel. Et maintenant, elle en était à exhumer ces images sous des monceaux de souvenirs en cendres. Que s’était-il passé ? Comment le temps avait-il pu filer si vite ? Mais ce jour-là, il avait vingt-quatre ans et elle vingt-deux, et ils filaient à toute allure sur la route qui descendait d’Anacapri, le village où ils logeaient, vers la côte la plus sauvage, disait-on, de l’île. Ils attachèrent leur engin à la Piazza Umberto I, avant d’emprunter un chemin débouchant sur un curieux piton rocheux qui, de l’endroit de la falaise où ils se tenaient, avait la forme d’un éléphant, avec sa trompe et ses hautes pattes surgissant de la mer.
De là démarrait le sentier qui menait à la Villa Malaparte… Dans les odeurs de pins, ils avaient longé les flots étendus à perte de vue. Jusqu’à ce que Sam s’arrête net devant l’impressionnante demeure. Celle-ci semblait lui rappeler des choses agréables qui n’avaient rien à voir avec le film auquel elle avait fourni son décor. D’ailleurs, ce n’était pas le genre de Sam de s’emballer pour les films d’art et d’essai. Elle et lui allaient peu au cinéma et quand c’était le cas, c’était pour voir des films américains. Quand il prononça le nom du réalisateur, Lena se souvint qu’elle ne l’aimait pas. Une ou deux fois elle l’avait vu à la télé, répondant à des questions de journaliste, et elle avait trouvé ce type à lunettes prétentieux. Dans son milieu, à l’école où elle était institutrice, les gens ne le connaissaient pas. Et de toute évidence, ses films ne s’adressaient pas aux enfants donc aucune chance pour que ses élèves lui en parlent… Sam était toujours à contempler la maison, sa terrasse rose corail traversée par un paravent, et malgré ses bras qui l’enlaçaient Lena sentait une distance, un fossé nouveau entre eux. C’était comme si l’endroit, cette villa juchée sur son caillou abritait un gros aimant qui attirait son homme, loin de leur bonheur. C’était idiot, elle le savait sans parvenir à dissiper son malaise. Mais tandis qu’elle laissait ce sentiment désagréable la submerger, Sam se pencha à son oreille : « Viens… »
« Mais tu es fou ! » Elle avait tenté de résister, mais il était trop tard, déjà son mari la poussait sur l’étroit chemin qui serpentait jusqu’à la maison en contrebas, celle de l’écrivain italien – elle apprit plus tard qu’un architecte l’avait conçue pour lui en ouvrant son guide. En quelques minutes, ils furent au pied de l’escalier rose. Lena hésitait encore, effrayée à l’idée que le propriétaire des lieux puisse les surprendre, mais Sam grimpa une volée de marches ; très vite il fut là-haut. Elle vit sa belle et solide silhouette découpée sur le ciel enfin bleu. Rassurée par le silence autour de la villa, excepté le bruit des vagues, Lena rejoignit Sam sur la terrasse surplombant la mer. C’était une vision magnifique. Elle eût envie de rire, d’ouvrir les bras, prendre son envol comme un oiseau. Sam lui fit danser une valse, danse qu’ils ne maitrisaient ni l’un ni l’autre et qui donna lieu à un enchaînement de pas maladroits, puis le vent se leva et ils s’abritèrent derrière le paravent, leur corps cachés par ce muret providentiel, enlacés avec la fièvre de deux survivants d’un naufrage en mer.
Neuf mois plus tard, Sofia, leur fille, était née. Suivie, quatre ans après, de Pierre et Ulysse, leurs jumeaux. Sofia ressemblait à son père, tandis que les garçons avaient plutôt pris ses traits à elle, Lena, même si le plus âgé des deux (d’une minute exactement, lui avait dit à l’époque la sage-femme !) vivait à Rome, et qu’elle ne le voyait pas très souvent. Sur les photos qu’il lui envoyait, Lena trouvait qu’il avait grossi… Sa vie d’écrivain sans le sou lui donnait du souci. Ulysse, quant à lui, venait la voir presque chaque semaine dans sa résidence pour vieux… Ou, plus précisément, sa résidence pour « personnes âgées autonomes. » Elle n’arrivait pas à se faire à ces mots, tant elle les trouvait lugubres, irréels. Certes son corps avait vieilli, mais Lena, elle, se voyait toujours jeune. Et quand il lui arrivait de croiser son reflet dans la glace, elle détournait les yeux, tant cette vision la faisait souffrir. Cette petite femme ridée et rabougrie, c’était bien elle ? Pas possible ! Cette image l’écorchait vive à l’intérieur. C’était la même chose lorsqu’elle croisait les ombres tassées des autres résidents dans le jardin : Lena avait envie de fuir, très loin, et surtout pas de se lier d’amitié avec l’un de ces sinistres vieillards qu’Ulysse, bon samaritain, voulait à tout prix lui mettre dans les pattes. Non, c’était non. Après tout, elle n’allait pas se forcer pour faire plaisir à son fils, ou pour rassurer Sofia, sa fille interprète à Paris qui venait lui rendre visite de temps en temps.
Si seulement Sam était là… Ces dernières années, elle avait fui son image, effacé jusqu’à son souvenir, de peur d’avoir mal. Penser à Sam, c’était se confronter inévitablement à la vision de son corps décharné, à sa figure exsangue, creusée par la maladie, cet affreux cancer. C’était revoir ses chairs disparaître, ses muscles s’évanouir, ce corps aimé, adoré, chéri, fondre en cendres, perclus de souffrance, la sienne mêlée à celle incommensurable de son mari, leurs deux douleurs ensemble et entremêlées. Sam était mort. Et elle avait tout fait pour ne plus y penser. Et voilà que, dix ans plus tard, un film à la télé ressuscitait un minuscule mais lumineux pan de leur passé ! Capri, la Villa Malaparte… Le corps nu de Bardot apparut à l’écran, contre le petit mur blanc de la terrasse rose, là même où elle et Sam avait fait l’amour. À l’époque, ils étaient jeunes et se croyaient éternels. Et maintenant elle allait bientôt mourir.
Après la Villa, ils avaient poursuivi leur promenade jusqu’à la pointe de l’île. On apercevait au loin les Faraglioni di Capri : trois pics érodés par le temps, détachés du littoral comme les pièces d’un puzzle morcelé, pareil à sa mémoire. Elle s’était tournée vers Sam, encore étourdie par leur étreinte, la lumière dorée éclaboussant l’immensité bleue, et vit qu’il saignait du nez. Une petite rigole rouge. Presque rien. Mais qui formait une blessure dans le paysage.